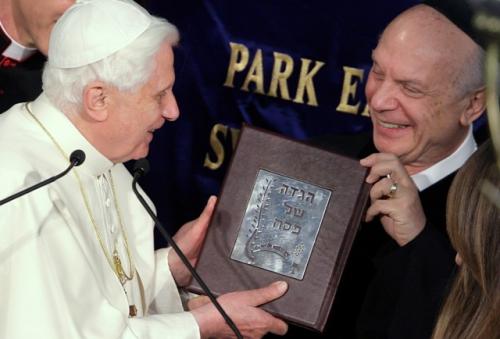Temps de lecture estimé : 4 min
Sur le chapitre VI de l’encyclique Redemptoris Missio
La coopération de tous les baptisés
Tous les baptisés sont appelés à coopérer à la mission auprès des non-chrétiens.
La « coopération missionnaire » de tous les fidèles se vit avant tout dans l’union personnelle au Christ qui seule peut produire de bons fruits.
Tous les chrétiens sont appelés :
– À suivre avec intérêt l’activité des missionnaires.
– À une coopération spirituelle : prière, sacrifice, témoignage de vie chrétienne.
– À promouvoir les vocations missionnaires.
– À aider matériellement la mission, si possible avec une dimension de sacrifice ayant un impact sur le style de vie afin que ce soit vraiment un témoignage de charité.
Saint Jean-Paul II appelle aussi les fidèles à garder un esprit missionnaire dans tous les aspects de leur vie séculière : travail, tourisme, politique, etc.